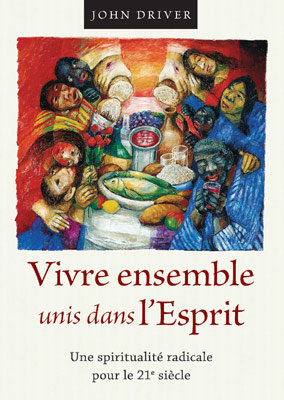Subtotal: $
Checkout-

Régénérer la terre
-

Évocation de la région du Weald
-

L’abîme de la beauté
-

Confiez le témoignage au corps
-

La Gloire des Créatures
-

La vie secrète des oiseaux
-

Pourquoi les enfants ont besoin de la nature
-

Les seigneurs de la nature
-

La ville des abeilles
-

Sœur Dorothy Stang
-

Soleil couchant
-

Le livre des créatures
-

Forum : Courrier des lecteurs
-

Mission vulnérable en action
-

Agriculture régénératrice dans le Weinland autrichien

L’article suivant:
Explore Other Articles:
Ma première année d'école sentait la cigarette. La salle de classe était comme une boîte – drapeau américain devant à droite, fenêtre devant à gauche (Je pense toujours à la droite et à la gauche en termes de drapeaux et fenêtres). Je passais la plupart de mon temps à regarder à gauche ; il y avait un nid d’hirondelle dans le lierre du bâtiment voisin. Le professeur était un peu ennuyé par les enfants gauchers. Ce sont presque les seuls souvenirs que je peux faire remonter à la surface lorsque mon enfant me demande comment était le CP. Mais le CE1 maintenant... ça se passait presque entièrement dans les bois de Piney. « C’est où ça ? Ça existe dans les contes de fées ? » Eh bien, oui, mon enfant. Voici l’histoire.
Dans les montagnes Allegheny de Pennsylvanie, au bord d’une clairière au sommet d’une colline à au Bruderhof de New Meadow Run, ont été plantés il y a longtemps des hectares de pins blancs en rangées parfaitement droites. Je n’ai aucune idée de l’usage auquel ils étaient destinés, mais pour un enfant dont la famille venait de déménager d’une maison surpeuplée dans une rue en pente raide de la ville, leur destin était d’offrir la liberté. On s’élançait entre des troncs pommelés par le soleil dont les branches les plus basses s’étendaient juste au-dessus de nos têtes ; on courait pieds nus, sans bruit, sur des tapis de douces aiguilles de pin ; on volait d’ombre en ombre pendant nos raids furtifs entre les campements de pirates et de princesses (féroces, les princesses !) ; on construisait dans les arbres des forteresses, toujours plus grandes et interconnectées ; on ramassait les branches tombées pour faire des feux de camp ; on faisait frire des beignets, cuire des pommes au four, des saucissons, des s'mores... Quels merveilleux souvenirs !
Nous avions aussi une salle de classe. Tous ces souvenirs me reviennent à volonté : des murs couverts de cartes, de listes d’oiseaux, de tableaux météorologiques. Nous avons passé une année scolaire aussi bien remplie qu’enrichissante. C’est juste que l’apprentissage en plein air était plus intense.
Les écoles Bruderhof mettent l’accent sur la science, la nature, l’exploration pratique. Il est rare de trouver une classe qui se passe à l’intérieur l’après-midi, qu’il pleuve, qu’il vente ou qu’il neige. Mais notre classe est passée au braquet supérieur, par pur esprit de contradiction. Grâce, en fait, à un professeur qui savait gérer la contradiction.
Notre équipe..., bref, disons simplement qu’après avoir eu affaire à nous, plusieurs élèves-professeurs se sont interrogés sur leur vocation. Avec seulement seize enfants, la classe aurait dû être aisément gérable, mais un certain nombre d’entre nous étaient encore un peu pommés dans la vie et la société, ou se heurtaient à des difficultés d’apprentissage ou de comportement, ou peut-être tout simplement étaient-ils nerveux et opposants par nature.

Toutes les photographies sont de Danny Burrows. Utilisées avec autorisation..
Notre professeur, Dick wareham,avait 61 ans, sa santé n’était pas excellente, et il avait fait une pause après des décennies d’enseignement. Je ne sais pas s’il a proposé de nous prendre ou si quelqu’un l’a supplié de le remplacer. Mais le jour où nous nous sommes retrouvés au sommet de la clairière, face à un homme de grande taille, un bandana rouge autour de la tête et un chronomètre en main, on s’est tous tus et mis en rang. En tout état de cause, c’était plus excitant que de se chamailler.
Dick avait construit une course d’obstacles qui exploitait tous les objets naturels et artificiels d’une boucle d’un kilomètre de champs et de bois, avec pavillon et aire de jeux pour faire bonne mesure. Les stations étaient numérotées à l’aide de petites étiquettes en bois. Au lieu d’organiser une compétition classique, nous devions nous mesurer à nous-mêmes, et améliorer notre vitesse et agilité au fil des mois. Bonne nouvelle pour un asthmatique mal coordonné...
À vos marques, prêts, partez ! Montez et descendez le cadre en acier de la balançoire, sautez par les six fenêtres ouvertes du pavillon, escaladez la cheminée en pierre et accrochez le numéro 3 au sommet (sautez à mi-chemin pour gagner deux secondes), restez en équilibre instable sur la balançoire à bascule, laissez-vous tomber et roulez sous le cadre (bon sang, vous venez de faire un accroc à votre chemise), marchez en équilibre sur la poutre d’équilibre (faites demi-tour si vous perdez pied), prenez votre élan et sautez la clôture dans Piney Woods, faufilez-vous à toute vitesse entre les troncs des pins alternés sur toute la longueur de la ligne (regardez à quelle vitesse vous courez en ligne droite quand vous en sortez) ; ensuite, on met la gomme jusqu’à la ligne d’arrivée, au moment de passer devant l’emplacement de notre club-house en forme d’appentis construit avec de petits arbres. Chaque fois qu’on fait ce parcours, on ressent une petite montée de fierté devant les murs et les poutres du toit bâtis par nos soins, pile au moment où faiblit le niveau d’oxygène dans les poumons.
Derrière vous, devant vous, à intervalles d’une minute, des amis et des ennemis volent sur la même piste, cherchant à atteindre le supplément de vitesse qui leur permettra de franchir la ligne d’arrivée avec un sentiment de réussite poussive.
Et c’était un vrai exploit, comme nous l’avons découvert à la fin de la saison, lorsque nous avons invité les papas à faire le même parcours, et que leurs résultats, très mitigés, nous ont fait bien rire. Dick a relevé tous nos temps, et ce n’était un secret pour personne que l’un d’entre nous, particulièrement rapide, allait toujours faire un temps de 5:07, mais le reste d’entre nous étions ravi d’entendre l’annonce de nos temps en constante amélioration, avec une solennité olympique. Tout progrès supplémentaire était célébré. Personne n'avait à s'inquiéter d’occuper le dernier créneau horaire, car il était déjà occupé. Voici la liste finale du classement de la saison : « Dick W : 28 minutes, 365 secondes ». Merci à tous ! On a tous passé du bon temps, sauf le dernier. Il faudrait qu’il se secoue un peu ! »”
En fait, nous ne savions pas que ce grand-père soi-disant si grand et lent, à qui nous conseillions de « se secouer un peu », avait été élu joueur de basket-ball vedette. L’équipe de son université avait parcouru le pays et affronté des écoles bien au-dessus de leur catégorie. Les recruteurs l’observaient, et Dick s’est vu proposer un contrat pour devenir joueur professionnel. Dans les années 40, c’était ce qui allait devenir les ligues de la NBA.
Il aurait pu réaliser son rêve de basket. Au lieu de cela, il a refusé l’offre et s’est inscrit au séminaire théologique de Bethany à Chicago, convaincu que Dieu avait prévu pour lui plus qu’une bonne technique de jeu. Or, le séminaire ne voyait pas l’intérêt d’enterrer un tel talent et le nomma directeur sportif et entraîneur de l’équipe de basket. En même temps, il travaillait comme conseiller pour les jeunes de l’Église des Frères. Pendant les cultes, les adolescents qui s’amusaient trop bruyamment et perturbaient l’assemblée étaient abordés avec humour, avec une foi tranquille et un défi à relever au basket-ball.
Si nous connaissons cette histoire, c’est que nombre de ces anciens perturbateurs de services religieux ont rejoint le mouvement Bruderhof plus tard, dans les années 1950, dont Dick et sa femme, Cosette, qu’il avait rencontrée lors des réunions de jeunes. En fait, l’un des meilleurs jeunes joueurs de basket de Bethany était Glenn Swinger, qui deviendra plus tard (bien plus tard) le grand-père de mon mari. Quand ils se sont tous retrouvés pour passer du temps ensemble, ils ont échangé des souvenirs comme en se renvoyant une balle à toute vitesse.
Mais les enfants de huit ans se soucient comme d’une guigne de ce que faisaient les vieux « à l’époque ». On savait juste que la vie était belle. À force de disputer des courses chacun pour soi, nous étions devenus une équipe : moins enclins à nous embrouiller pour la satisfaction éphémère de déclencher une bagarre, et plus enclins à marcher en formation serrée autour de l’instituteur en gravissant la colline vers « notre » clairière. Nous aimions cet homme qui n’élevait jamais la voix, mais forçait toujours notre attention.
Personne ne nous obligeait à rester ensemble, mais si on traînait à l’arrière, on risquait de ne jamais savoir pourquoi les cirrostratus créent un effet de halo autour du soleil, et quel genre de temps ils annoncent. On avait de fortes chances de manquer la course du tangara écarlate entre les chênes verts. Et de ne jamais savoir si ces baies vertes d’hiver étaient comestibles, ni comment utiliser cette écorce de bouleau déchiquetée pour allumer un feu même si le bois est un peu humide. (C’est grâce à leur huile.) Si une pluie de météorites était inscrite au calendrier du ciel pour cette nuit-là, personne d’autre ne harcelait nos parents pour les convaincre de sortir de la maison et les regarder avec nous. « Les Perséides… quoi ? »
La lecture de cartes et de boussoles, le repérage, l’observation de la météo, la cuisine en plein air, la convivialité avec les autres humains – tout cela semblait simplement se produire tout naturellement au fil de nos journées. Mais je m’en souviens maintenant sans effort, alors que j’ai oublié tout ce que j’ai étudié au cours des années suivantes, et ça ne me dérange pas.

J'ai appris q'une légende de notre village veut que notre clairière s’appelait « La Clairière » parce que l’homme qui avait eu l’idée d’aménager un petit espace de pique-nique parmi les arbres avait embauché un conducteur de bulldozer pour déblayer du terrain jusqu'à ce qu'on lui dise d'arrêter. Malheureusement, le visionnaire avait dû partir d’urgence en voyage, tandis que le conducteur du bulldozer poursuivait stoïquement son œuvre de déforestation – plusieurs jours de trop. C’est ainsi que naquit notre vaste clairière bien-aimée, qui offrait beaucoup d’espace de jeux et de courses... et qu’il avait fallu « éclaircir » la situation au retour du voyageur.
Le projet de défrichement s’est déroulé bien des années bien avant qu’il nous soit donné d’en profiter nous-mêmes, mais ce merveilleux montagnard à l’initiative du bulldozer était encore bien vivant lorsque notre classe fit une excursion d’une journée dans sa propriété. Il nous a montré sa fosse grouillant de crotales des bois. « Ce sont mes animaux de compagnie », nous a-t-il assuré. « On ne trouve pas plus affectueux ».
« Affectueux, tu parles ! », remarqua Dick, en retournant avec nous à la fourgonnette. « Jusqu’à ce que l’un d’eux regarde l’autre de travers, et là, c’est bataille de queux et crochets garantie ». Je ne sais toujours pas à quoi il faisait allusion...
Notre point d’attache était certes la clairière et Piney Woods, mais nous rayonnions de partout à partir de là : pour rendre visite à nos voisins, étudier les champs de bataille de la guerre d’indépendance et les ruines des forts, chercher des fossiles dans les anciennes carrières et nous baigner au barrage de Youghiogheny. Les après-midis de « temps libre », chacun pouvait donner libre cours à sa créativité pour exploiter ces quelques arpents de nature sauvage. Construire des barrages, attraper des écrevisses, tailler dans une branche une sculpture improbable – Dick était toujours d’accord, tant qu’on lui indiquait où nous serions pour qu’il puisse venir nous chercher.
Il savait toujours où trouver mon amie Liz et moi : près du ruisseau qui traverse la prairie en dessous de l’école. Un vieux pommier avait poussé sur la berge. Son tronc s’était fendu en deux et il offrait de grandes branches plates, une pour chacun de nous. Nous nous y sommes vautrés comme des léopards littéraires, une pile de livres en équilibre à portée de main. Un arbre battu par le vent est le meilleur endroit pour se délecter de récits d’aventures en haute mer. (Les pommes vertes constituent une excellente défense contre les maraudeurs en approche, et font un excellent ravitaillement à consommer sur le pont du navire).
Ce pommier est toujours là, mais plus le bâtiment de l’école. Je ne retourne pas dans la maison de mon enfance aussi souvent que je le voudrais, et quand j’ai la chance de pouvoir y aller, j’essaie de ne pas m’exclamer : « Oh, cela, ça a disparu ! Ceci a changé ! » Je déteste entendre de telles lamentations de la bouche d’autrui ; pourquoi le temps devrait-il se figer simplement parce que nous avons été heureux quelque part ? Je suis tout de même soulagée que le vieil arbre n’ait pas été déraciné ; il est resté exactement le même, et je m’attends presque à voir une petite pomme verte dégringoler entre les feuilles – peut-être lancée par une ombre de mon enfance, piquée d’être interrompue en plein au milieu d’un chapitre. Mais bon, je n’ai jamais su très bien viser.
Piney Woods, cependant, est un mur impénétrable de sous-bois enchevêtrés et de branches mortes. Mais pourquoi se lamenter ? Les pins blancs ne sont pas éternels, et les enfants de cette communauté ne manqueront jamais d’endroits où jouer. Pourquoi devrais-je encore croire que princesses et pirates féroces dorment encore depuis cent ans derrière ce mur, alors que nous sommes tous devenus adultes et avons nos propres petits pirates à affronter ?
Dick wareham est décédé d'un cancer en 2001, à l'âge de soixante-seize ans. Pendant les derniers jours de sa vie, beaucoup d’entre nous ont eu la chance de venir passer du temps avec lui et Cosette, et le remercier d’avoir été ce professeur formidable. Pourtant, le meilleur hommage qu’il reçut fut improvisé. Vers la fin de cette année-là, New Meadow Run accueillit un rassemblement de jeunesse. Plus d’une centaine de jeunes, issus d’une douzaine de communautés, sont un après-midi partis faire une randonnée à travers la clairière en longeant la lisière des bois. Liz et moi nous sommes revus et nous sommes retrouvés en queue de peloton – nous n’étions pas les derniers, mais presque. Je ne me souviens plus lequel d’entre nous a dit : « Si la balise numéro trois est toujours là, allons-y ».
Nous étions sur le point d'atteindre le vieux pavillon, et quelqu'un s'est détaché du troupeau, a grimpé le long de la cheminée en pierre, a frappé le sommet du plat de la main et a sauté en bas. Quelques instants plus tard, quelqu’un d'autre a fait de même. Nos compagnes et compagnons ne savaient plus s’ils devaient sourire, hausser les épaules ou nous demander des explications. Je ne sais plus si on leur en a donné. On était déjà arrivés et avions retrouvé les familières prises pour les mains et les pieds, tout usées (mais nous n’en avions désormais besoin que de la moitié), et sept autres personnes avaient déjà effectué notre pèlerinage vertical. Pour autant que je sache, nous étions tous d’anciens participants à la convention.
En fin de compte, je ne vais pas faire le deuil de cette vieille forêt – c’est elle qui me vient à l’esprit quand mes enfants me demandent comment s’est passée mon enfance. Le soleil de l’après-midi traverse les longues allées vertes, les aiguilles sont douces sous le pied, l’air sent la poix de pin, et nous rions en courant vers le colosse au chronomètre, qui est toujours fier de nous, quel que soit le temps que nous réalisons..