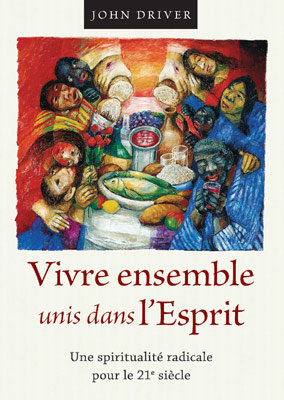Subtotal: $
Checkout
Pardonner à un parent
Ces histoires nous montrent qu’il faut toujours envisager la possibilité d’une réconciliation, même dans le cas de parents particulièrement cruels.
par Johann Christoph Arnold
mardi, le 1 juin 2021
Il est libérateur de prendre conscience du fait que nous ne sommes pas condamnés à être des victimes de notre passé et du fait que nous pouvons apprendre de nouvelles façons de réagir. Mais nous pouvons franchir un pas de plus : celui du pardon. Le pardon est l’amour en actes pour ceux qui aiment mal. Il nous libère sans rien attendre en retour. (Henri J. M. Nouwen)
Dans un monde où d’innombrables personnes ont souffert dans leur enfance d’abus physiques, psychologiques ou sexuels, il n’est pas étonnant que la télévision, la radio, et la presse ne se lassent pas de tirer parti de ces thèmes, enchaînant jour après jour histoire sordide sur histoire sordide. Les émissions télévisées où les victimes s’épanchent devant un public curieux mais finalement blasé et insensible, ne se comptent plus. Pourtant, mettre ainsi leur cœur à nu ne semble pas apporter aux victimes la guérison qu’elles espèrent.
Où et comment peuvent-elles la trouver ?
Il est évident que chaque cas étant particulier, chaque famille étant différente, il est impossible d’offrir des suggestions ou des conseils qui s’appliquent à tous. Et pourtant, les histoires qui suivent nous montrent qu’il faut toujours envisager la possibilité d’une réconciliation, même dans le cas de parents particulièrement cruels. Elles manifestent aussi la résilience de l’esprit humain, même s’il a été broyé, et l’espoir qui jaillit de ce qui devient une mystérieuse source de force quand nous sommes prêts à l’utiliser – et que nous appelons l’amour.
Don a grandi dans une ferme des Appalaches, au sein d’une famille élargie qui comptait une quarantaine de membres. Ils habitaient tous sous le même toit, vivant chichement d’un petit lopin de terre. Son enfance fut des plus rudes. Il raconte comment des cousins tentaient de se pendre les uns les autres, et comment l’une des grands-mères tirait sur les enfants désobéissants avec un fusil chargé de gros sel.
Quand Don a dix ans, son père trouve du travail à Long Island, où ils s’installent. Leur situation financière s’améliore, mais pas leurs relations. Peu après le déménagement, la mère de Don quitte le foyer familial, abandonnant ses enfants aux mains de leur père. Il les bat si souvent qu'ils vivent dans la terreur constante de ce père violent. Don se souvient encore de la peur qu’il ressentait tous les jours au creux de l’estomac, quand le car scolaire le déposait non loin de chez lui après l’école et qu’il rentrait, plein d’appréhension à la pensée de ce que la soirée lui réservait.
Un jour, le père de Don est gravement blessé dans un accident qui le laisse tétraplégique. Autrefois tyran du foyer, il est à présent un paralysé entièrement dépendant des autres.
À la place de Don, beaucoup se seraient enfuis d’un tel foyer à la première occasion, mais pas lui. Lui qui a pourtant toutes les raisons du monde d’abandonner son père, choisit de rester à ses côtés, le nourrissant, le lavant, l’habillant et faisant bouger ces bras qui l’avaient autrefois frappé sans pitié, parfois jusqu’à l’assommer. Don est aujourd’hui marié et s’est arrangé pour que son père reçoive une assistance 24 heures sur 24 mais il vit non loin de là et lui rend de fréquentes visites.
Quand on lui demande pourquoi il a fait ce choix, Don n’a que peu de choses à dire. Jamais il n’a considéré sa décision de rester près de son père comme héroïque, ni comme un sacrifice. À vrai dire, il n’y a jamais longuement réfléchi. Que pouvait-il faire d’autre ? Comment pouvait-il quitter la maison alors que l’homme qui lui avait donné la vie gisait aussi impuissant qu’un bébé et qu’il n’y avait personne d’autre pour l’aider ? « Papa avait besoin de moi, alors je suis resté. »
Il arrive que de mauvais souvenirs viennent encore hanter la mémoire de Don, et son père, dit-il, a toujours ses vieux démons. La vie est loin d’être un chemin de roses, mais au moins, ils peuvent se parler et partager le poids des combats qu’ils doivent mener. En outre, en s’occupant de son père, Don a trouvé un certain bonheur, celui qu’il espérait si fort quand il était enfant. « Appelez ça du pardon si vous voulez, dit-il. » Quoi qu’il en soit, un vide dans le cœur de Don a été comblé, un sentiment de guérison en a pris la place.
Karl Keiderling, un ami de la famille mort il y a quelques années à plus de quatre-vingts ans, a connu lui aussi une enfance difficile. Fils unique d’un ménage allemand d’origine modeste, les premières années de son enfance furent assombries par la seconde guerre mondiale et ses désastreuses conséquences économiques. Il perd sa mère quand il a quatre ans et sa belle-mère quand il en a quatorze. À ces souffrances s’ajoute celle d’être considéré comme un fardeau par son père. Quand celui-ci, à la recherche d’une nouvelle mère pour ses enfants, met une annonce dans un journal, il omet délibérément de mentionner son fils : « Veuf avec trois filles cherche gouvernante, possibilité mariage ultérieur. »
Plusieurs femmes répondent à l’annonce ; l’une d’elles décide de rester. Ce n’est qu’une fois installée qu’elle réalise qu’il y a un garçon dans la maison, ce qu’elle ne devait jamais vraiment accepter. La nourriture de Karl est toujours plus pauvre que celle des autres, et elle se plaint constamment de lui.
Non seulement le père de Karl ne fait rien pour prendre la défense de son fils face à sa nouvelle épouse, mais il s’associe à elle pour le maltraiter et il le bat souvent. Son instrument préféré est une ceinture en cuir à boucle de cuivre. Quand Karl cherche à se protéger, cela ne fait qu’attiser la colère de son père et ajouter aux nombre de coups qu’il reçoit à la tête et au visage.
Contrairement à Don, Karl quitte le foyer à la première occasion. Attiré par un mouvement de jeunes qui faisait fureur à l’époque, Karl rejoint les rangs d’un groupe d’ouvriers socialistes qui voulaient changer le monde. Ses errances le mènent finalement à une petite communauté naissante, où mon grand-père l’accueille à bras ouverts avec ces mots : « Nous t’attendions. »
Karl se sent immédiatement chez lui et décide de rester. Il se jette à corps perdu dans le travail, fendant du bois, portant de l’eau et s’occupant du jardin. Mais la souffrance de son enfance si douloureuse ainsi que le ressentiment contre son père et sa belle-mère l’habitent toujours. Jour après jour, son amertume s’accumule comme un nuage sombre au-dessus de lui, menaçant de l’empêcher de faire l’expérience des belles choses de la vie.
Karl décide un jour de se confier à mon grand-père. Il ne s’attend pas à la réponse qu’il reçoit : « Écris à tes parents et demande-leur pardon pour toutes les fois où tu as pu les blesser ou leur causer du chagrin. Concentre-toi sur ta propre culpabilité, non sur la leur. » Karl est si surpris qu’il lui faut du temps pour rédiger la lettre. Quand il le fait enfin, il est très étonné de recevoir quelque temps après une réponse de son père.
Celui-ci ne lui a jamais demandé pardon pour toutes les fois où il l’a battu quand il était enfant. Pas plus qu’il n’a reconnu la moindre culpabilité. Mais pour Karl, cela n’a plus d’importance. Par le pardon, il s’est libéré du fardeau de sa colère, laissant la place à une paix profonde. Karl ne s’est plus jamais plaint de son enfance.
C’est de la même façon que Maria, une cousine du côté de ma belle-famille, put dépasser le ressentiment qu’elle éprouvait envers un père abusif :
Ma mère est morte à l’âge de quarante-deux ans, laissant mon père et huit enfants âgés de un à dix-neuf ans. Sa mort fut un choc énorme pour toute la famille, mais plus particulièrement pour mon père qui fit une dépression nerveuse au moment où nous avions le plus besoin de lui. L’une des conséquences de son instabilité d’humeur était son manque de maîtrise de lui-même – il tenta des attouchements sur moi et sur l’une de mes sœurs. Je me mis à l’éviter puis à le haïr.
Peu de temps après, mon père déménagea et je quittai l’Amérique du Sud pour étudier en Allemagne. Sept ans s’écoulèrent sans que je le voie, mais je m’accrochais à ma haine et elle grandissait en moi.
Plus tard, à mon retour d’Europe, je me fiançai à un ami d’enfance. Mon père demanda à me rencontrer, mais je refusai catégoriquement. Je n’avais aucun désir de le revoir. Quand mon fiancé apprit ce qui s’était passé, il ne comprit pas mon refus. Si mon père avait exprimé le désir d’une réconciliation, n’était-ce pas mon devoir d’y répondre ? Après un long combat intérieur, et vu l’insistance de mon fiancé, je me ralliai finalement à son point de vue.
Nous retrouvâmes mon père dans un café. Avant que je puisse dire un seul mot, mon père se tourna vers moi, brisé, et me demanda pardon. Je me retrouvai désarmée, mon cœur s’ouvrit à lui et je lui assurai mon pardon à l’instant même. Il m’aurait été impossible de le lui refuser.
Malgré l’apparente facilité avec laquelle Don et Maria ont pardonné à leurs pères respectifs, les maltraitances de l’enfance sont probablement la chose au monde la plus difficile à pardonner. Étant donné le déséquilibre de pouvoir entre l’adulte (l’agresseur) et l’enfant (la victime), la responsabilité est unilatérale. Pourquoi l’innocent pardonnerait-il au coupable ?
Beaucoup d’enfants victimes d’abus croient à tort qu’ils sont en partie responsables – et c’est là le drame. Ils s’imaginent qu’ils sont pour quelque chose dans ce qui leur arrive ou, pire encore, qu’ils le méritent. De fait, une grande partie du pouvoir qu’a l’auteur de tels méfaits sur sa victime, même après que les abus ont cessé, vient de cette fausse idée, chez l’enfant, de sa complicité.
Pire encore, certaines personnes prétendent que lorsqu’une victime pardonne à son agresseur, elle (la victime) sous-entend qu’elle est au moins en partie responsable. Mais rien n’est plus loin de la vérité. Le pardon est nécessaire simplement parce que la victime tout comme l’agresseur – qui, dans la plupart des cas, se connaissent ou sont même apparentés – sont enfermés dans des ténèbres dont ils resteront tous deux prisonniers jusqu’à ce que quelqu’un ouvre la porte. Le pardon est la seule voie de sortie, et même si l’agresseur choisit de rester dans cette obscurité, cela n’empêche pas la victime de choisir la lumière.
Kate est une voisine qui a la cinquantaine au moment où j’écris. Sa mère, alcoolique, l’a maltraitée pendant des années, mais elles sont aujourd’hui réconciliées. Son cheminement nous montre comment, quand une victime est transformée par le désir de pardonner, l’agresseur peut à son tour être touché et changer.
Aînée d’une famille de cinq enfants, je suis née peu après la seconde guerre mondiale dans une petite ville du Canada. Mon père travaillait dans le bâtiment à environ quarante kilomètres de chez nous. Entre ses longues journées de travail (il travaillait douze heures par jour) et ses trajets, il passait très peu de temps à la maison.
Nous avions toujours des problèmes financiers, mais il y avait aussi d’autres tensions dans la famille, que je ne m’expliquais pas. Tout ce que je savais, c’est que plus je grandissais, plus la situation se dégradait, particulièrement après la naissance de mon plus jeune frère. J’avais alors neuf ans. Avec le recul, je vois clairement aujourd’hui ce qui s’est passé : maman s’était mise à boire.
Quand la mère de Kate se mit à rentrer à la maison ivre, ses parents se séparèrent – et il n’y eut plus aucune vie de famille. La maison était mal entretenue, le linge sale s’accumulait. Tout reposait désormais sur Kate et ses treize ans.
Quand Jamie, le dernier, commença l’école, maman n’était pour ainsi dire plus jamais à la maison. Je ne trouvais jamais le temps de faire mes devoirs, j’apprenais peu et dus redoubler ma troisième. Plus tard, deux de mes sœurs trouvèrent du travail et quittèrent la maison pour s’installer dans un appartement loué en ville. Mais je restai. Il fallait bien que quelqu’un s’occupe des plus jeunes et même si je n’étais pas à la hauteur, ils avaient au moins quelque chose à manger.
Puis ma mère découvrit une nouvelle source de revenus : afin de décharger d’un excédent de patients les hôpitaux pour handicapés physiques et mentaux, le gouvernement offrait des subsides aux personnes qui prendraient chez elles certains patients « en trop ». C’est ainsi que ma mère hébergea deux hommes d’un certain âge et une femme. Il me fallut donner mon lit à l’un des deux hommes et partager un grand lit avec la femme, qui dormait très peu. Quand un jour, n’en pouvant plus, je demandai à ma mère de la renvoyer à l’hôpital, j’essuyai un refus. Ma mère tenait trop au chèque qu’elle touchait à la fin de chaque mois.
Ma mère dit qu’elle rentrerait le soir à la maison pour m’aider, ce qu’elle fit pendant un temps. Mais dans quel état d’ivresse ! Elle me disait que sans moi, elle ne serait pas dans un tel pétrin. Je ne découvris que plus tard ce qu’elle voulait dire par là : mes parents avaient dû se marier parce que ma mère était enceinte de moi.
Il arrivait même qu’elle me frappe. Quand, le lendemain matin, elle me demandait d’où venaient les traces de coups sur mon visage, je lui disais que c’était elle. Alors elle me traitait de menteuse.
À seize ans, Kate quitta l’école pour se consacrer entièrement à ses frères et sœurs. C’est à peu près à cette époque qu’elle rencontra son futur mari, Tom, qu’elle épousa deux ans plus tard. Elle se souvient encore de son sentiment de culpabilité quand sa mère lui lança, sur un ton plein de reproche : « Et qui donc va faire le travail, maintenant ? » Kate n’en quitta pas moins la maison. Bientôt, Tom et elle élevaient leurs propres enfants.
À cette époque, tout ce que je voulais, c’était oublier ma mère. J’avais ma propre petite famille, et j’avais les parents de Tom, qui adoraient nos enfants. Puis un jour, ma mère manifesta soudain le désir de renouer avec moi. Je refusai. J’avais enfin un certain pouvoir sur elle, et j’allais lui rendre la pareille.
Mes parents avaient alors divorcé, et ma mère qui, par miracle, s’était rendu compte que l’association de l’alcool et des médicaments pour la tension la tuerait, avait cessé de boire. Malgré cela, je n’avais aucun désir de la revoir. Je ne pouvais vraiment plus lui faire confiance.
Quelques années plus tard, après la naissance d’un autre enfant, Kate découvrit que son mari avait reçu un appel de sa mère. Celle-ci demandait à leur rendre visite et Tom lui avait répondu qu’elle serait la bienvenue.
J’entrai dans une colère noire. « Rappelle-la immédiatement, lui dis-je, et dis-lui qu’elle ne peut pas venir ! Dis-lui ce que tu veux, cet enfant est mon enfant et je ne le partagerai pas avec elle. » Je fus très désagréable. Plus tard cependant, cet épisode se mit à me tourmenter. Je m’en ouvris à notre pasteur, pensant que lui, peut-être, aurait une solution.
Le pasteur m’écouta sans rien dire pendant que je lui exposai mon dilemme. Quand j’eus fini, il ne disait toujours rien. J’attendis. J’avais le sentiment d’avoir entièrement raison d’avoir agi ainsi envers ma mère, mais je voulais son approbation. Je ne l’obtins pas. Il me dit simplement :
– Il vous faut faire la paix avec votre mère.
– Vous ne connaissez pas ma mère, lui répondis-je.
– Cela n’a rien à voir, dit-il.
Entre-temps, ma mère vint en séjour chez nous. À son arrivée, elle n’allait pas bien et avait besoin qu’on s’occupe d’elle, mais je lui rendis la vie aussi difficile que je pus.
Puis, pendant les derniers jours de sa visite, je sentis qu’elle avait quelque chose à me dire. Elle semblait même prête à écouter ce que moi j’avais à lui dire. Au cours de notre conversation, je réalisai que ma mère voulait une nouvelle relation avec moi, (j’en étais moi-même arrivée à vouloir désespérément la même chose) et qu’elle souhaitait ôter tous les obstacles qui pouvaient nous séparer. Je sus à cet instant qu’il me fallait lui pardonner, ce que je fis. Je sentis alors une vague de soulagement, quelque chose en moi était guéri. C’est impossible à décrire, mais à ce jour encore, j’en garde le souvenir très vivace.
Tous les cas d’éloignement entre parents et enfants ne sont pas aussi nets que ceux que nous venons de décrire. Le cas de Susan, une Californienne, est très différent. Elle ne fut pas à proprement parler maltraitée par ses parents, mais elle éprouva malgré tout, et pendant des années, une grande amertume envers sa mère, qu’elle trouvait froide et distante. Comme Kate, elle découvrit que le seul chemin qui pouvait mener à leur guérison réciproque, c’était de reconnaître ses propres manques d’amour et d’être prête à pardonner.
J’ai toujours eu, aussi loin que je me souvienne, des relations difficiles avec ma mère. Je redoutais ses colères explosives, ses remarques mordantes et sarcastiques. Rien de ce que je faisais ne lui plaisait. Je finis par nourrir envers elle une colère croissante qui couvait silencieusement au fond de moi, et me fermai complètement à elle. Je ressassais le souvenir des injustices subies, des paroles tranchantes et des quelques coups reçus (qui ne valaient pourtant pas la peine qu’on s’en souvienne). Je devins extrêmement sensible au moindre reproche et me sentais facilement rejetée.
Comme je n’avais jamais eu de relations ouvertes et de confiance avec ma mère, je me tournai vers les autres adultes dans ma vie, particulièrement mes professeurs. Ma mère acceptait mal l’attachement que j’avais pour eux, mais elle ne sut jamais s’exprimer à ce sujet. Je me souviens avoir souhaité être retirée à ma famille pour être adoptée par l’un d’eux. Je me rappelle aussi un ressenti presque physique de solitude mais, dans mon désir d’être acceptée, je me gardais bien de l’exprimer et m’efforçais d’être très sage.
À l’adolescence, la situation ne fit que se dégrader. Je découvris toutes sortes de façons d’exprimer subtilement ma colère par des moyens détournés et de faire ce que je voulais. Je découvris également de nouvelles façons de faire des choses dans son dos. Pour me venger, j’allai jusqu’à avoir une amourette secrète avec le prêtre de notre paroisse, qui entretenait avec mes parents des rapports amicaux.
Cette liaison prit fin et, devenue étudiante, je m’installai dans un appartement à moi. Quelque temps plus tard, je me mariai. Et je ne m’entendais toujours pas avec ma mère. À vrai dire, notre relation était étrange parce que, malgré cela, je voulais encore terriblement lui plaire.
Au cours de cette période, ma mère traversa plusieurs longues épreuves physiques et psychologiques, mais je n’éprouvais pas pour elle de véritable compassion et ne manifestais que peu d’intérêt. Ce n’est que lorsqu’elle eut rejoint un groupe des Alcooliques Anonymes que je lui tendis enfin la main. Nous passâmes ensemble une merveilleuse semaine, à bavarder et à communiquer vraiment. Puis, brutalement, la porte se referma à nouveau. Je l’en rendis responsable même si aujourd’hui, je ne peux dire pourquoi.
Finalement, je pris conscience du fait que la force et l’assurance apparentes de ma mère n’étaient qu’une carapace qui cachait son insécurité et les blessures de sa propre enfance. Chacune à sa façon essayait de tendre la main à l’autre, mais nous avions toutes deux si peur d’être rejetées qu’il nous était impossible d’être totalement vraies. Nos efforts restaient superficiels.
La situation se débloqua quelques années plus tard. Une amie tenait absolument à ce que j’écoute la cassette d’une conférence d’un certain Charles Stanley, écrivain. Je n’avais jamais entendu parler de lui mais comme, à l’époque, je cherchais des réponses à certaines questions importantes que je me posais, je l’écoutai – avec méfiance. Je ne me souviens plus précisément des paroles du conférencier, mais il parlait des liens affectifs et j’entendis exactement ce que j’avais besoin d’entendre. Les paroles de Charles Stanley m’aidèrent à voir que ma mère et moi avions toutes deux une part de responsabilité dans la distance qui nous séparait et que tant que l’une ne demanderait pas pardon à l’autre, le fossé ne serait pas comblé.
Peu après, je rendis visite à mes parents. Une fois seule avec ma mère, je lui demandai pardon pour la façon dont je l’avais traitée dans le passé, et je lui dis aussi que je lui pardonnais. J’avouai avoir été en colère contre elle toute ma vie, sans vraiment comprendre pourquoi. Elle ne comprit pas d’où venait ma colère mais me demanda pardon à son tour pour la souffrance qu’elle m’avait causée. Elle ajouta : « Le passé est le passé, et nous ne pouvons pas le changer. Mais nous pouvons le laisser derrière nous et aller de l’avant. »
Ces mots tout simples sont d’une importance vitale pour toute personne qui se sent enlisée dans le bourbier d’une relation difficile. Nul ne peut changer le passé. Mais chacun peut choisir de pardonner, et retrouver sa liberté pour aller de l’avant.