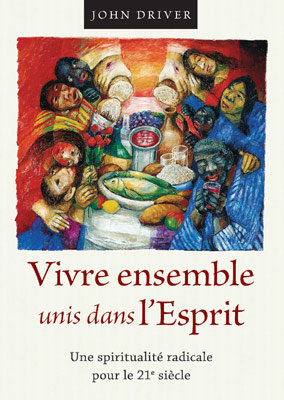Subtotal: $
Checkout
La clémence en actes
La réconciliation exige que nous ouvrions les bras à la personne qu’il nous serait pourtant bien plus facile d’éviter.
par Johann Christoph Arnold
mercredi, le 7 juillet 2021
Aussi, toi qui plaides pour obtenir justice, considère ceci : avec la seule justice, aucun de nous ne serait sauvé. Nos prières invoquent la clémence, et ces mêmes prières à tous nous apprennent à faire acte de clémence. (William Shakespeare)
Dans son roman Quand l’oiseau disparut, Alan Paton raconte l’histoire d’un homme respecté de tous qui commet un acte que la société dans laquelle il vit juge impardonnable : l’adultère. Quand l’affaire éclate au grand jour, il voit son univers s’effondrer. Abandonné par ses amis, rejeté par sa famille, il perd aussi son père, qui meurt dans la honte. Seul un voisin hésite : « Celui qui est coupable peut être puni, dit-il, mais punir sans réconciliation possible, c’est infliger la pire des blessures […]. Si un homme s’approprie le droit divin de punir, alors il doit aussi s’approprier la promesse divine de la réconciliation. »
S’il y a un concept qui porte en lui les contradictions apparentes du mystère que nous appelons pardon, c’est bien l’épineux sujet de l’offense. La plupart d’entre nous trouvons difficile de mettre derrière nous certaines offenses subies, même relativement petites, et pourtant, la réconciliation va beaucoup plus loin : elle exige que nous tentions réellement d’ouvrir les bras à la personne qu’il nous serait pourtant bien plus facile d’éviter.
Chris Carrier, natif de Miami, avait dix ans lorsqu’il fut kidnappé par un ancien employé de la famille. L’homme, après l’avoir violemment agressé, lui tira une balle dans la tête et le laissa agonisant dans le parc national des Everglades, en Floride. Mais son histoire ne s’arrête pas là :
Ce vendredi 20 décembre 1974 n’était pas un jour comme les autres. C’était le dernier jour d’école avant les vacances de Noël et on nous laissa partir tôt.
Je descendis du bus à 13 h 15 et pris le chemin de la maison. Un homme d’âge moyen qui marchait vers moi sur le trottoir sembla me reconnaître. Nous n’étions qu’à deux maisons de la mienne. Il m’accosta, se présentant comme un ami de mon père. Il m’expliqua qu’il organisait une fête en l’honneur de mon père et me demanda si je voulais bien l’aider avec les décorations.
J’acceptai et remontai la rue avec lui jusqu’à la Maison des Jeunes où il avait garé sa caravane. Une fois à l’intérieur, je posai mes affaires et m’installai. Il démarra. Nous nous dirigions vers le nord, et bientôt nous quittâmes le Miami qui m’était familier. Sur une route déserte, il arrêta son véhicule, prétendant qu’il avait manqué un carrefour. Il me tendit une carte routière en me demandant de chercher une certaine route et disparut à l’arrière de la caravane, « pour prendre quelque chose », ajouta-t-il.
Tandis que j’étudiais la carte, je sentis une violente douleur à l’épaule, puis une seconde. Comme je me retournai, je le vis debout derrière moi, un pic à glace à la main. Il me tira de mon siège et me poussa sur le sol. À genoux, penché sur moi, il me frappa à la poitrine à plusieurs reprises. Je le suppliai d’arrêter, lui promettant que s’il me relâchait, je ne dirais rien.
Mon soulagement fut immense quand il se releva. Il me dit qu’il allait me déposer quelque part puis qu’il appellerait mon père pour lui dire où j’étais. Il me permit de m’asseoir à l’arrière de la caravane et démarra à nouveau. Malgré sa promesse, j’avais la conscience aiguë et douloureuse que la situation m’échappait complètement. Quand je lui demandai pourquoi il me faisait du mal, il me répondit que mon père lui « avait fait perdre beaucoup d’argent ».
Nous roulâmes ainsi pendant environ une heure, puis il prit un petit chemin de terre et s’arrêta. Il m’emmena dans des buissons et me fit asseoir, me disant que c’est là que mon père viendrait me chercher. Je n’ai plus aucun souvenir de la suite, si ce n’est celui de sa silhouette qui s’éloignait.
C’est un chasseur qui retrouva Chris six jours plus tard, le soir du 26 décembre. Chris avait la tête ensanglantée, les yeux noirs et tuméfiés. Il avait reçu une balle dans la tête. Par miracle, il n’avait pas de lésion au cerveau – mais il ne se souvenait pas du coup de feu.
Pendant les années qui suivirent, Chris, sachant que son agresseur était en liberté, vécut dans la peur au quotidien :
Partout où j’allais, j’étais hanté par l’angoisse de ce qui m’attendait au coin de la rue, de ce qui me guettait dans l’ombre menaçante. Je sursautais au moindre mouvement, au moindre bruit. Cette ombre, était-ce un chien ? Et ce bruit, était-ce vraiment seulement le vent ? Et ce craquement dans la pièce voisine ? Quelqu’un tentait-il d’entrer par l’arrière de la maison ? Pendant trois ans, j’ai passé toutes mes nuits dans un sac de couchage au pied du lit de mes parents.
Chris dut aussi accepter peu à peu les limites physiques, conséquences de ses blessures : il était à présent aveugle d’un œil et ne pouvait plus participer à certains sports. Et puis, comme tout adolescent, il était préoccupé de son apparence.
Chris n’aimait pas que l’on évoque en public le « miracle » de sa survie. S’il y avait là un « miracle », se demandait-il alors, comment se faisait-il qu’il fût si malheureux ? Quand il eut treize ans, un changement s’opéra en lui. Il commença à voir le cauchemar qu’il avait vécu sous un autre angle : ses blessures auraient pu être bien pires – de fait, il aurait pu mourir. Prenant aussi conscience de ce que, s’il restait en colère, rien ne changerait, il prit la décision de cesser de s’apitoyer sur lui-même et d’aller de l’avant.
Le 3 septembre 1996, un nouveau changement survint dans la vie de Chris. Il reçut un appel de la police de Coral Gables, en Floride, l’informant qu’un certain David McAllister, pensionnaire d’une maison de retraite, avait avoué être son ravisseur. Il l’était, mais on ne trouva légalement pas assez de preuves de sa culpabilité pour qu’il soit jugé. David McAllister avait autrefois été employé par la famille Carrier, travaillant au service d’un oncle âgé. On l’avait renvoyé à cause de son problème de boisson. Chris lui rendit visite dès le lendemain.
J’eus un bref moment de malaise quand j’entrai dans la pièce, mais dès que je le vis, j’éprouvai pour lui une immense compassion. L’homme que je voyais n’était pas un ravisseur menaçant mais un homme frêle de soixante-dix-sept ans, qui était aveugle depuis six ans. Son corps, qui paraissait ne peser guère plus de trente kilos, était ravagé par l’alcool et le tabac. Il n’avait pas de famille – ou en tout cas, celle qu’il avait ne voulait rien avoir à faire avec lui. Et il n’avait pas d’amis. Tout ce qu’il possédait, c’étaient quelques dessins que des enfants d’une école voisine avaient dessinés pour lui. David ne communiquait même pas avec le pensionnaire qui partageait sa chambre – de ce fait, ils ne se connaissaient pas. J’avais devant moi un homme face à la mort, avec ses regrets pour seuls compagnons.
Quand je m’adressai à David, sa première réaction fut brusque. J’imagine qu’il me prenait pour un agent de police. Un ami qui m’avait accompagné eut l’idée judicieuse de lui poser quelques questions simples, le conduisant à admettre qu’il était mon ravisseur. Mon ami demanda ensuite : « Avez-vous jamais espéré pouvoir demander pardon à ce jeune garçon pour ce que vous lui avez fait ? » La réponse de David fut claire et immédiate : « Oui, j’aimerais pouvoir le faire. » C’est à ce moment que je lui dis qui j’étais.
David, qui ne pouvait me voir, étreignit ma main et me demanda pardon. Penché au-dessus de ce vieillard, je fus comme submergé par une vague : qui donc mérite d’affronter la mort seul, sans famille, sans amis, sans aucune des joies de la vie – sans espoir ? Je ne pouvais faire autrement que de lui offrir mon pardon et mon amitié.
Dans les temps qui suivirent cette poignante rencontre, Chris rendit visite à David aussi souvent qu’il le put. Il était souvent accompagné de sa femme, Leslie, et de leurs deux filles. Les deux hommes passèrent des heures ensemble à parler, à lire et même à prier. Au fil du temps, la dureté du vieil homme s’adoucit peu à peu.
Au cours de cette semaine, j’ai raconté à David ma vie depuis cette journée d’horreur où il avait tenté de me tuer, et les victoires successives de mon rétablissement. Après le lycée, j’avais fait des études supérieures. Je m’étais marié, j’avais une épouse et des enfants merveilleux. Je lui ai fait part de tout cela pour qu’il comprenne – comme Joseph, dans la Genèse, tentant de faire comprendre à ses frères, qui l’avaient abandonné : « Vous avez cherché à me faire du mal, mais Dieu l’a transformé en bien. » Je lui fis ainsi savoir que somme toute, il n’avait pas détruit ma vie et que plus rien ne nous séparait à présent.
David mourut trois semaines plus tard, quelques heures après que Chris eut couché et bordé pour la dernière fois son ami souffrant. Chris affirme qu’il ne lui fut pas difficile de pardonner. Pourtant, les journalistes qui s’intéressèrent plus tard à son histoire ne sont encore à ce jour pas capables de comprendre comment ni pourquoi il a accordé son pardon. Ils admirent sa capacité à pardonner, mais ils ne comprennent pas ce qui l’a motivé. Ils ne trouvent rien à dire dès que la question du pardon est abordée, explique Chris, et il semble qu’il leur soit plus facile de s’arrêter à la tragédie de son rapt, de son agression et aux détails de ses tortures. Mais Chris, lui, sait pourquoi il a pardonné :
Il y a une raison très pragmatique au pardon. Quand on nous fait du mal, nous pouvons chercher la vengeance – ou nous pouvons pardonner. Si nous choisissons la vengeance, notre vie sera rongée par la colère. Et quand la vengeance est accomplie, chaque jour nous laisse vide. La colère est une pulsion difficile à vraiment assouvir et elle peut devenir une habitude. Le pardon, lui, permet d’aller de l’avant.
Et puis, il y a une autre raison qui force le pardon. Il est un don – il est aussi clémence. C’est un cadeau que j’ai reçu et que j’ai aussi donné. Dans un cas comme dans l’autre, il m’a pleinement comblé.
Quand la tristement célèbre « criminelle au pic », Karla Faye Tucker, fut exécutée à Huntsville, dans le Texas, de petits groupes de personnes opposées à la peine de mort se rassemblèrent pour une veillée silencieuse avec des bougies. Mais parmi les centaines de personnes qui se trouvaient au pied du mur de la prison, bien plus nombreuses étaient celles qui étaient là pour célébrer son exécution. La pancarte que brandissait un homme résumait tout avec ces quelques mots : « Que le Ciel vous vienne en aide – parce que soyez sûre que l’aide ne viendra pas de nous ! »
Dans la prison, cependant, Ron Carlson priait pour Karla. Il ne se trouvait pas dans la salle pour les familles des victimes (où il aurait eut le droit d’être), mais dans l’autre pièce, celle pour les proches du meurtrier[1]. Cela fait maintenant deux ans que j’ai rencontré Ron et qu’il m’a raconté son incroyable cheminement de la haine au pardon, mais je me souviens encore de son récit comme si c’était hier :
Nous étions le 13 juillet 1983. Je venais de rentrer chez moi après une journée de travail fatigante quand le téléphone sonna. « Ronnie, me dit mon père, viens vite au magasin. Je crois que ta sœur a été assassinée. » J’étais atterré. Je ne pouvais y croire. Même quand j’ai vu, à la télévision, le corps de ma sœur qu’on transportait hors d’un appartement, je ne pouvais y croire.
Déborah était ma sœur, elle m’avait élevé. Mes parents avaient divorcé quand j’étais très jeune et ma mère était morte quand j’avais six ans. Je n’avais pas d’autre frère ou sœur – je n’avais qu’elle, et je tenais beaucoup à elle. Beaucoup.
C’est elle qui m’avait vêtu, elle qui m’avait nourri ; elle qui m’avait aidé à faire mes devoirs ; elle qui me donnait une tape sur la main quand je faisais une bêtise. Déborah était devenue comme ma mère.
Et maintenant, elle était morte, le corps percé de douzaines de trous, et le pic qui avait servi à les faire était resté planté dans son cœur. Déborah n’avait aucune raison d’avoir des ennemis. Elle s’était simplement trouvée au mauvais endroit, au mauvais moment. Les meurtriers s’étaient introduits dans la maison où elle se trouvait pour voler des pièces de motos. Ils avaient découvert la présence de Jerry Dean – l’homme avec qui elle était – et l’avaient assassiné à coups de pic. Ils étaient sous l’emprise de la drogue. Puis ils avaient découvert Déborah. Alors ils l’avaient tuée, elle aussi.
La ville tout entière fut sous le choc, les titres des journaux clamaient les détails sanglants du crime, et Houston vécut dans la peur. Quelques semaines plus tard, les meurtriers – deux toxicomanes, Karla Faye Tucker et Daniel Ryan Garrett – furent dénoncés par des membres d’une de leurs familles. Ils furent jugés et condamnés à mort par injection létale (Daniel devait en fait mourir en prison d’une maladie du foie). Cette condamnation n’apporta à Ron aucun soulagement.
J’étais certes heureux qu’on les ait arrêtés – mais je voulais plus. Je voulais les tuer moi-même. Dévoré par une haine aveugle, je voulais la vengeance. Je voulais planter ce même pic dans le cœur de Karla, comme elle l’avait planté dans le cœur de ma sœur.
Ron explique qu’il avait un problème de drogue et d’alcool avant la mort de sa sœur, et qu’après son enterrement, il s’enfonça dans cette dépendance. Puis, un an plus tard, son père fut tué d’une balle.
J’étais souvent ivre, je me défonçais au LSD, à la marijuana, à tout ce qui me tombait sous la main, et aussi souvent que je le pouvais. Rempli de colère, j’avais avec ma femme de fréquentes disputes. J’avais même envie de me suicider…
Un soir, je n’en pus plus. Je pense que j’en étais arrivé à un point tel qu’il fallait que je fasse quelque chose de la colère et de la rage qui s’accumulaient en moi. Je ne voulais plus rien d’autre que tout casser et tuer. J’étais en train d’emprunter le même chemin que ceux qui avaient tué ma sœur et mon père. À tout hasard, j’ouvris une Bible et je me mis à lire.
C’était vraiment bizarre. Les joints que je fumais me faisaient planer – et j’étais en train de lire la Parole de Dieu ! Quand j’en arrivai au passage où ils crucifient Jésus, je refermai le livre. Je ne sais pas pourquoi, ces mots me frappaient comme jamais ils ne m’avaient frappé : mon Dieu, ils ont même tué Jésus !
Puis je me mis à genoux – ce que je n’avais jamais fait – et demandai à Dieu d’entrer dans ma vie, d’être le Maître de ma vie et de faire de moi celui qu’il voulait que je sois. Voilà en gros ce qui s’est passé ce soir-là.
Un peu plus tard, je repris ma lecture. Quelques mots du Notre Père – là où Jésus dit : « pardonne-nous comme nous pardonnons… » – me sautèrent aux yeux. Le message me paraissait clair : tu ne seras pardonné que si tu pardonnes. Je me revois me disant « je ne peux pas, non, jamais je ne pourrai faire ça », et Dieu semblait me répondre : « Ron, toi, tu ne peux pas – mais par moi, tu peux. »
Peu de temps après, j’étais au téléphone avec un ami et il me demanda tout à coup si je savais que Karla était en ville, à la prison du comté de Harris. « Tu devrais y aller et lui dire ses quatre vérités », me dit-il. Cet ami n’avait aucune idée de mon cheminement spirituel et je ne lui dis rien. Mais je décidai d’aller voir Karla.
Quand je vis Karla à la prison, je lui dis que j’étais le frère de Déborah. C’est tout ce que je dis pour commencer. Elle me regarda :
– Tu es le frère de qui ??
Je répétai. Elle me regardait fixement, comme si elle n’en croyait pas ses oreilles. Puis elle se mit à pleurer.
– Karla, lui ai-je dit, quoi qu’il advienne de tout ça, je veux que tu saches que je te pardonne et que je n’éprouve aucune rancœur envers toi.
C’est à ce moment que je fus libéré de toute ma haine, de toute ma colère, comme si un immense fardeau était ôté de mes épaules.
Ron raconte qu’il a ensuite parlé longuement avec Karla. Au cours de leur discussion, il découvrit qu’elle aussi était venue à croire en Dieu et que sa foi avait changé radicalement le regard qu’elle portait sur la vie. Ron prit alors la décision de revenir pour en savoir plus sur elle.
Au début, je voulais simplement la voir, lui pardonner, en rester là et continuer mon chemin. Mais après cette première visite, j’ai éprouvé le besoin de retourner la voir. Je voulais savoir si elle était vraiment sincère quand elle parlait du cheminement de foi qu’elle prétendait vivre. Je voulais aussi comprendre pourquoi des gens tuent, pourquoi des gens s’entretuent. Je n’ai pas trouvé de réponse à ces dernières questions, mais j’ai vu que Karla était sincère. C’est aussi grâce à elle que j’ai découvert que les gens peuvent changer et que j’ai découvert la réalité de Dieu.
La mère de Karla, toxicomane et prostituée, avait introduit sa fille très jeune dans le monde de la prostitution et de la drogue. Karla avait dix ans quand elle se drogua pour la première fois. Ce n’est qu’en prison qu’un changement radical s’opéra en elle, grâce au service d’aumônerie de la prison du comté de Harris qui venait en aide aux femmes, leur donnait des Bibles et les aidait à trouver une raison de vivre.
Pendant les deux années qui suivirent, Ron rendit visite à Karla tous les deux mois environ. Il entretenait également une correspondance avec elle et ils devinrent rapidement liés par une profonde amitié. Ron se souvient :
Les gens n’arrivaient pas à comprendre. Ils disaient qu’il y avait quelque chose qui n’allait pas en moi – qu’il me fallait haïr la personne qui avait tué Déborah et non pas lui tendre la main. Un membre de ma famille me reprocha de déshonorer le souvenir de ma sœur, disant qu’elle se retournait probablement dans sa tombe. Un autre fit une déclaration publique le jour de l’exécution, décrivant sa joie et celle de sa famille à la pensée de la mort prochaine de Karla. « Nous avons un dicton au Texas, dit-il : ce qu’on donne, on le reçoit en retour. »
Karla elle-même n’en revenait pas de l’attitude de Ron envers elle. À des journalistes de la télévision hollandaise venus l’interviewer peu de temps avant son exécution, elle déclara : « C’est incroyable. Le pardon est une chose, mais aller au-delà du pardon, me tendre la main – m’aimer vraiment… ? » Il lui était presque plus facile de comprendre les milliers de Texans qui voulaient sa mort. Elle disait :
Je comprends leur rage – qui ne la comprendrait pas ? Elle est l’expression de leur peine, de leur souffrance. Je sais bien que les gens pensent que je ne mérite pas qu’on me pardonne. Mais qui le mérite ? J’ai reçu une vie nouvelle et l’espoir – la promesse – que cette vie ici-bas n’est pas la réalité finale.
Karla affronta la mort avec courage. Elle prononça ses dernières paroles avec le sourire : « Je regrette si profondément… J’espère que par tout ceci, Dieu vous donnera la paix. » Et tandis qu’on l’attachait à la table d’exécution et qu’on injectait dans ses veines les poisons mortels, elle parut murmurer une prière.
Quant à Ron, il maintient que la mort de Karla n’a servi à rien. « Tuer ne sert personne, nos rues n’en sont pas plus sûres. Tout ce que cela fait, c’est plus de victimes. C’est sûr que ma sœur me manque. Mais Karla me manque aussi. »
[1] Au Texas, un certain nombre de témoins peuvent assister, à travers une vitre, à l’exécution. Deux salles sont prévues à cet effet : l’une pour les proches de la victime, l’autre pour les proches du condamné.