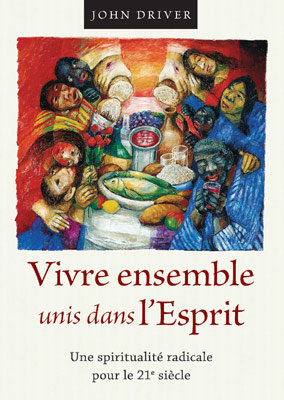Subtotal: $
Checkout
La misère prend essentiellement un seul visage aujourd’hui. Il s’agit d’une même maladie : l’individualisme cause la misère du monde, et la misère du monde réside dans l’individualisme. Nous ne pouvons la comprendre que de cette manière. Nous la vaincrons en la prenant sur nous, et en nous unissant dans la foi. La misère n’existerait pas dans ce monde si, au lieu de s’en écarter, les individus y consacraient leurs efforts. Tant que la misère durera dans le monde, nul ne pourra prétendre s’en déclarer quitte ou innocent.
Notre époque se consume dans la souffrance et la misère. Elle gît dans la mort, tout en s’accrochant à ce qui lui reste de « vie », si immonde soit-elle. Comme des moribonds, en ce temps de ruine, nous nous accrochons à notre mal, à notre plus extrême misère, parce qu’il ne nous reste rien d’autre à quoi nous tenir. Nous ne discernons pas encore le but de la vraie vie. La foi demeure sans objet. Il ne reste que l’incrédulité. Le poète tourmenté de notre époque ignore le sens de la vie, il ne connaît pas le Dieu qui se tient en face de lui, qui l’attend et lui offre un avenir :
« Tu es mon Juge ! Mais je ne sais rien du jour qui vient. Tu es mon Juge, mais j’ignore si tu siègeras au tribunal ! – Pourtant, je n’ai pas peur du jour de ton jugement. Toi, mon Juge, je ne te crains pas, avec ta grandeur ! C’est moi que je crains. C’est de moi que j’ai peur. Je ne sais pas si tu existes, mon Juge. Mais j’espère bien que tu existes, mon Juge ! » footnote
On reste dans cette mélancolie du solitaire, avec son Moi en proie à la torture. On s’oblige à partager la souffrance et la mort de tous. Le désir d’aimer est là. Mais il manque le pouvoir et la possibilité d’aimer vraiment, d’aimer effectivement : « Moi aussi, je suis prisonnier ! Tout aspire à aimer. Et je languis d’amour. Je pleure moi aussi ; je voudrais aimer mais je n’y arrive pas. » footnote L’ « amour » est sans effet. Il ne reste que son absence. Malgré sa profondeur et le sérieux de son expression, il n’arrive pas à dépasser une douce jouissance de la douleur, une sympathie pour la faiblesse.
Un amour effectif ne peut venir que d’une souffrance endurée. Notre vie doit devenir l’écho d’un appel à agir, réclamé par ce qui nous unit les uns aux autres. C’est Dieu qui rend la conscience active, quand elle s’imprègne de la certitude de la proximité du Royaume de Dieu. On peut alors répondre à ces cris de la misère : « Cela ne devrait pas exister ! », « ce n’est pas possible ! ». Des paroles libératrices surgissent de la certitude que donne la foi : « Il n’en sera pas toujours ainsi », « la vie est plus forte que la mort ».
Nous restons loin de l’assurance de ce renouveau, tant que nous ne plongeons pas dans la profondeur des ténèbres de la nuit, au cœur des plus intolérables souffrances. Certes, nous pouvons avoir le sentiment « de prendre part à la mort du monde entier, de mourir avec les miséreux, de crever comme un chat ou une rosse, de dépérir comme un soldat dans le désert, ou de s’effondrer comme un forçat. » footnote
Certains estimeront suffisant ce partage subjectif des sentiments. Ils diront :
« Je connais ce que peut ressentir une harpiste dans un ensemble de musique de chambre, le trouble d’un jeune acteur qui s’approche en tremblant du trou du souffleur. J’ai vécu dans la forêt. J’ai travaillé dans une gare. Courbé sur des livres de comptes, j’ai dû m’occuper de clients énervés. Chauffeur, je me suis trouvé devant des chaudières ; mon visage a souffert de la violence des flammes. Comme un coolie, j’ai mangé des déchets et des restes de repas. » footnote
Nous croyons peut-être sortir de notre individualisme, de cette solitude qui ne connaît que son « Je suis », avec cette empathie pour la misère des autres. Nous croyons connaître ce que signifie communier à l’âme du monde, en limitant son agonie à l’épuisement d’un cheval de fiacre, à la noyade d’un marin, à la faim d’un enfant d’ouvrier. footnote Celui qui se laisse émouvoir et troubler par cette sensibilité commence à pressentir la volonté de l’Esprit. Mais il convient d’aller plus loin que ce sentiment de communion avec un « esprit universel » de la souffrance, auquel il serait possible de s’adresser, bien que l’on ne puisse pas lui dire « tu » mais seulement « nous » : « Je te donne un nom, et je dis de toutes choses : nous sommes. » footnote
Cette manière d’embrasser le monde entier en s’identifiant mentalement au « nous » de tout ce qui existe reste encore dans la sphère du désir érotique, qui cherche à retrouver en chaque créature une jouissance de la douleur. On en reste au désir insatiable de l’aspiration de l’existence qui cherche partout, inexorablement, à satisfaire sa compassion, sa soif inextinguible de vivre, son appétit de pouvoir. Il s’agit encore de l’expression d’un égoïsme primitif : Tout, je peux tout – mais « il n’est pas question que je me sacrifie» footnote. Pourtant, c’est seulement en empruntant le chemin d’un vrai sacrifice que la puissance du Moi individualiste, plein de bons sentiments, peut être brisée. Comme dans notre corps, où la vie est maintenue et assurée par l’offrande perpétuelle des petites cellules. Dans le corps aussi, il faut une mort sacrificielle des individus. C’est ainsi que perdure et se renouvelle la vie de l’ensemble.
Pour entrer en communion avec les millions d’êtres humains qui souffrent, qui sont opprimés, qui n’ont plus qu’un semblant d’existence, qui soupirent, étouffent, tremblent à cause du fardeau de la vie et de la crainte de la mortfootnote, il faut prendre la peine de participer personnellement à leur misère. Cette communion n’est possible que si l’on s’expose au risque d’une communauté de vie quotidienne avec ceux qui meurent corporellement et spirituellement, en partageant le caractère effrayant de leur existence. L’immense souffrance du monde, cette misère de l’humanité qui cherche vainement une issue, ne s’appréhende que par une compassion active, le partage de la pauvreté, de l’humiliation, du manque. Il ne sera possible de l’exprimer par des mots qu’à partir du moment où on l’aura profondément intériorisée. Quand on ose prendre part aux souffrances et à l’existence de ceux qui sont dans la plus grande détresse, on commence à comprendre ces paroles de Schopenhauer : « L’optimisme est une manière perverse de penser. C’est tourner en ridicule la souffrance innommable de l’humanité » footnote. Jouir de ce qu’il y a de bon dans le monde, de la joie de vivre, ou simplement de « la justice de l’histoire universelle » s’avère impossible quand on entre vraiment en communion avec l’injustice dont pâtissent les masses.
Nos tentatives actuelles pour nous plonger dans le bourbier de la sympathie ne sont que le revers de la médaille de l’optimisme joyeux. Même le pessimisme devient jouissance chez une âme sensible qui embrasse le monde. Nos émotions vont dans ce sens, mais n’apportent aucune solution à la misère. Au contraire, elles révèlent la fausseté de nos sentiments, l’hypocrisie et la duplicité qui nous habitent. Ce Moi, cet individualisme, en se mettant en avant, prouve que, loin d’être sauvé, il ne fait qu’aggraver la misère du monde.
La misère, chez l’être humain, se concentre dans une souffrance qui n’arrive pas à sortir de ses limites. L’individu voit le mal dans le monde ; il en ressent la douleur. Mais ce mal habite aussi en lui-même et le fait souffrir. Il ne trouve pas dans son âme ce qu’il ne trouve pas dans le monde. Il est donc vain pour le Moi de tenter de se fondre avec le monde entier pour entrer en communion avec lui. Il fait jaillir une source de ses profondeurs, mais une source polluée. Les barrières entre le Moi et le vaste monde peuvent tomber, puisque, en fait, la misère du monde est la détresse de chaque individu. Le monde des conflits, le monde des combats et de la haine, le monde des divisions et des destructions, reste enfermé en chacun. De la même manière qu’il habite les guerres, les luttes de classes et les crises économiques des sociétés humaines.
D’où l’effroi de l’esprit, quand enfin il se reconnaît. Sa prière s’élève alors vers le Père : « Libère-moi, purifie-moi, mon Père ! Fais mourir cet ennemi ! Fais-moi mourir ! Noie ce Moi ! » footnote Il faut qu’il s’accuse, qu’il se condamne, avec une haine fanatique, violente : « Ils se sont moqués de moi : falot, mauviette, vaniteux, mou, inintéressant, trop petit pour pécher, incapable de faire le bien, faible dans l’offense, sans repentir. Je les ai entendus, et je me suis retourné contre moi-même. Je leur ai donné raison – ô mon Juge ! Il faut que je me haïsse ! » footnote
Alors chacun connaît son malheur d’être déchiré, divisé en lui-même. Il sait qu’il est son propre ennemi. Un ennemi sur lequel il déverse sa haine, parce qu’il l’attaque, le harcèle, « dilapide le bien de son âme », détruit sa conscience, éteint son amour. Il l’ « entraîne à toutes bassesses », au point de s’écrier dans son tourment : « Pourquoi, mon Père, m’as-tu créé avec cet ennemi en moi ? Pourquoi m’as-tu fait pour cette duplicité ? Pourquoi ne m’as-tu pas fait don de l’unité et de la pureté ? Toi qui es la source, purifie-moi, unifie-moi ! Vois, tous tes enfants : Quand ils le découvrent, ils ne peuvent que se lamenter sur le chiffre deux ! » footnote Le Deux a pris la place du Un : telle est la malédiction qui cause notre misère. La division dans la solitude est la misère du monde.
De nos jours, la misère du monde se trouve inextricablement liée au sentiment de culpabilité qu’éprouve l’individu en raison de la division qu’il ressent en lui-même. Le péché affaiblit mortellement l’énergie de l’amour, qui est source de vie. L’individualisme, le fait de se couper de l’ensemble du monde, réduit l’amour à néant. La malédiction de la médiocrité et de la division entrave toute décision et accomplissement. La souffrance du monde dans la vie sociale est liée à la faute personnelle de chaque individu. Il convient ici de rappeler les inquiétantes paroles de Schopenhauer :
« Pour connaître la valeur morale des êtres humains, il suffit de considérer le sort qui leur est commun : le manque, la misère, la détresse, la souffrance et la mort… S’ils n’étaient pas tous indignes, leur sort commun ne serait pas si triste. (…) Si l’on plaçait la souffrance du monde sur le plateau d’une balance et sa culpabilité sur l’autre plateau, l’aiguille resterait sans doute au centre. » footnote
L’opposition entre ce qui devrait être et ce qui est, le fossé qui sépare la vocation première de l’être humain et l’impitoyable réalité qui est devant nos yeux, nous interrogent : Où se situe la blessure mortelle de l’existence ? Par quoi la vie a-t-elle été empoisonnée ? Existe-t-il une racine empoisonnée qui serait à l’origine de la souffrance ? Une source empoisonnée de la souffrance ? Une plaie inguérissable qui causerait la misère du monde, qui le ferait mourir d’hémorragie – oui, inguérissable, puisque aucune guérison n’est en vue ?
Nul n’a autant ressenti la souffrance des êtres humains que Jésus. C’est lui, et nul autre, qui a discerné et révélé la racine de la souffrance. Il connaissait mieux que quiconque les besoins des hommes. Il savait que leur misère est profondément enracinée dans leurs cœurs partagés, dans le tréfonds divisé de l’être humain. Il a mis en lumière ce qu’est le cœur de l’homme. Il a dévoilé ce qui l’empoisonne : cette coupure, cette distance qui nous sépare des autres.
L’empoisonnement du sang de l’humanité est si profond, si généralisé, qu’il est devenu impossible de mesurer la gravité d’une faute personnelle en fonction de l’intensité d’une souffrance. En entendant la terrible nouvelle selon laquelle Ponce Pilate avait mêlé le sang d’être humains à celui d’animaux destinés aux sacrifices, Jésus déclara :
« Pensez-vous que ces Galiléens étaient de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens pour avoir subi un tel sort ? Ou pensez-vous que ces dix-huit personnes sur lesquelles est tombée la tour et qu’elle a tuées, étaient plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem ? Non, je vous le dis, mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de la même manière. » footnote
Prendre conscience de notre propre culpabilité est un pas décisif pour retrouver la vie : Toute notre vie, le tout de notre vie, avec tout ce qui lui est lié, est pourri, ruiné, mortellement empoisonné, au point qu’un criminel ne serait pas plus coupable que nous. Nous tous sommes définitivement condamnés. L’ « innocent » assassiné est aussi coupable que le meurtrier – voilà la prise de conscience décisive ! Cette « vie » que nous vivons aujourd’hui, toute notre vie, il nous faut confesser qu’elle est mauvaise. Elle pourrit et détruit tout. Nous devons reconnaître en elle un mal personnel, mais aussi un mal général : notre faute contribue à la misère mortelle du monde entier. Confesser cette faute générale et personnelle est le pas ultime et décisif qu’il nous reste à faire en tant qu’êtres humains.
Nous tous sommes définitivement condamnés.
La détresse qui naît de la prise de conscience de cette culpabilité est une souffrance ultime et décisive. Nous connaissons le tourment indicible et cruel de Luther, dans sa tour noire. Celui qui ne sait rien de la misère de Luther dans sa solitude, sa déréliction, son désespoir, ne peut pas comprendre la foi de Luther. Ce n’est qu’en partant de sa souffrance, quand il se sentait confronté à un Dieu lointain et en colère, que l’on peut comprendre l’assurance et la joie de sa foi, devenues chez Luther une nouveauté absolue :
« Je connais un homme qui affirmait avoir passé bien souvent par ces transes, pendant un temps très court, il est vrai, mais elles étaient si intenses et si infernales qu’aucun langue ni aucune plume ne sauraient les décrire et celui qui n’en a pas fait l’expérience ne saurait le croire. C’est au point que, s’il fallait les supporter jusqu’au bout ou si elles duraient une demi-heure ou même seulement la dixième partie d’une heure, on en périrait tout entier et tous les os seraient réduits en cendre. Alors Dieu apparaît horriblement irrité, et avec lui de même toutes les créatures. Impossible de fuir, pas moyen de trouver une consolation, ni en soi-même, ni au-dehors : de tous côtés, ce n’est qu’une accusation. » footnote
Luther en est arrivé à haïr complètement le Dieu « juste » : Il le voyait, en face de lui, empli de colère et de châtiment. Il faisait en vain d’immenses efforts pour l’apaiser et retrouver sa communion. Nombreux sont ceux qui font une expérience semblable, confrontés à la misère actuelle. Mais dans une autre mesure : leur sentiment de culpabilité est plus superficiel. Ils ressentent comme « injuste » le châtiment que Dieu fait peser aujourd’hui sur l’humanité. Même si nous sommes bien loin de la détresse de Luther, même si nous ne parvenons pas à ressentir ses tourments en raison de nos fautes, nous péchons nous aussi contre une volonté de communion. Nous nous trouvons dans la même solitude que lui. Nous ne parviendrons pas à vaincre la misère du monde, parce que nous n’allons pas au bout de la recherche de la cause dernière de la souffrance : le fardeau qui pèse sur notre conscience en raison de notre isolement et de notre individualisme.
La seule chose dont nous aurions besoin, c’est d’authenticité. L’authenticité d’un solide réalisme, capable de reconnaître dans la plus petite portion d’existence l’immense responsabilité de la culpabilité de tous. Il nous suffirait de porter notre regard sur le plus petit d’entre nous pour ressentir la misère et le mal qui nous menacent comme une épée au-dessus de notre tête et qui trouvent leur origine dans l’individualisme généralisé. L’enfant est perdu au sein de l’humanité. Le jardin de l’enfance devient un désert triste et désolé. Voilà la plus convaincante des preuves de l’étendue de la destruction de l’humanité par notre faute. Le paradis d’une communion en Dieu est perdu pour la terre, parce que, pour nous, le lien vital de la communion avec Dieu s’est rompu.
Il suffirait d’accueillir un seul de ces enfants issus de la détresse tant matérielle que spirituelle pour reconnaître le lien naturel qui unit la misère du monde et la faute individuelle : la destruction, la déchéance du monde de l’enfance viennent de notre péché, du fait que notre intérêt se détourne égoïstement du reste du monde et se concentre sur nous-mêmes.
Combien d’enfants d’ouvrières grandissent pratiquement sans leur mère ! La mère est tellement accaparée par le travail en usine, les tâches ménagères, les sollicitations de son époux et l’éducation des enfants, que l’enfant ne peut pas trouver son épanouissement au sein d’une vie saine et communautaire.
Ces petits naissent de parents malades et épuisés par une exploitation impitoyable. La vie en gestation est déjà marquée par la tragédie : l’enfant souffre de la faim dès le sein de sa mère au travail, malade à force d’endurer la cruauté d’une humanité qui n’épargne pas la mère enceinte ou allaitante. Ce péché de l’humanité, qui frappe les premiers surgissements de la vie, imprime sur l’enfant le cachet de la dégénérescence. Il apparaît souvent désespéré d’amener un tel enfant, malade dès sa naissance, à une vie normale en communauté.
Combien d’enfants d’ouvrières grandissent pratiquement sans leur mère !
La paralysie de l’élan vital, à sa racine, ne provient pas que du surmenage de la femme qui devient mère en travaillant. Cette ombre funeste sur la vie à naître ne vient pas seulement d’une dégradation de la santé causée par les produits toxiques et chimiques des usines, qui détruisent l’intérieur du corps maternel et qui ont pour conséquences maintes fausses couches et une forte mortalité infantile.
En fait, l’empoisonnement, avec ses graves conséquences, a des origines encore plus terribles : les relations infidèles, adultères, qui ne cherchent qu’à assouvir un désir sexuel illimité, et qui favorisent la propagation de maladies vénériennes. Il est fréquent d’observer un enfant doué, plein de vitalité et de vivacité, s’effondrer subitement avec des convulsions. Le médecin fait une prise de sang et détecte chez l’enfant la syphilis. S’ensuivent alors pour l’innocent des traitements terribles dont l’issue, après des souffrances sans nom, reste incertaine. L’avenir de l’enfant se trouve menacé par des problèmes de santé, qui sont un héritage de nuits irresponsables.
Des millions d’enfants illégitimes naissent parmi nous chaque année, qui paient le prix de la conduite irresponsable et intolérable de pères qui, quant à eux, continuent à vivre confortablement, voire même très confortablement. Au cours de leur enfance et de leur jeunesse, ils subissent les conséquences de l’abandon de leurs parents: les voilà mis au ban de la société, ou pire encore, victimes de lourds handicaps physiques.
Fréquemment, on s’en doute, des mères se font avorter de leur enfant et gardent un meurtre sur leur conscience. Si tel n’est pas le cas, dans leur malheur, elles n’ont pas la possibilité d’offrir à leurs enfants la chaleur d’un véritable amour maternel. Quand nous découvrons le drame de ces « enfants non désirés », ce qu’ils vivent et ressentent, nos yeux s’ouvrent. Le plus impitoyable d’entre nous est confronté à la réalité. Et nous pouvons nous accuser en nous adressant les plus durs reproches : comment, dans notre égoïsme individualiste, avons-nous pu passer à côté de ces monstruosités ?
A proximité de chez nous, le cinquième enfant naît pour mourir. Abandonné par les foules de nos grandes villes, il subit un lent empoisonnement. L’alimentation qu’il reçoit dans son biberon contribue à l’affaiblir ; ce qu’on mélange à son lait le fait davantage mourir que vivre. Pire encore : il existe des situations maudites où l’enfant est nourri d’alcool à la place du lait ! L’alcool et la syphilis provoquent généralement des lésions corporelles et psychologiques extrêmement graves, qui se répercutent sur trois ou quatre générations.
On pourrait résoudre ces problèmes aujourd’hui, ou au moins les réduire, si les hommes se ressaisissaient, ne serait-ce qu’un peu, pour retrouver un esprit communautaire ! Quand on examine les statistiques de la criminalité et des familles alcooliques, il apparaît clairement que la double déchéance de l’immoralité et de la maladie, qui se transmet dans les familles, accroît encore terriblement la misère du monde.
Quand bien même le tout-petit passerait ces premiers récifs mortels, la plupart des enfants pauvres souffrent d’une pénurie de logements, au milieu d’un océan d’habitations. Ils sont errants dans leur propre pays. Ces malheureux manquent de l’air sain nécessaire à leurs poumons, dans leurs sous-sols, mansardes, baraques ou arrière-cours. Un million d’êtres humains « vivent » aujourd’hui en Allemagne à quatre dans une pièce, 600 000 végètent à cinq dans une seule chambre, généralement petite, exiguë. Comment imaginer leurs conditions de vie, quand on n’y a pas grandi ? Qui s’en préoccupe, ne serait qu’un peu ?
Il faut nous accuser : nous avons été confrontés à cette misère du monde toute proche, sans éprouver de compassion ou de sympathie. Pas une seule fois, nous ne leur avons rendu visite. Nous savons pourtant prendre du temps pour nous reposer. Chaque jour, après notre travail – qui peut effectivement avoir été difficile – nous nous accordons un moment de détente pour nous faire du bien ! Nous sommes individualistes et égoïstes. Nous ne prenons pas le temps de nous rendre près de chez nous, là où chaque jour il nous serait possible d’entrer en contact avec la misère du monde.
Imaginons une seule de ces « chambres » : elle n’est jamais grande – il s’agit d’une petite pièce, dans laquelle cinq personnes doivent survivre jour et nuit. Il n’y a pas de lit pour tous – non, et précisément, le fait que, dans ces pièces, à longueur de journées, plusieurs personnes partagent un même lit, est un signe des temps qui révèle notre responsabilité ! Respirons l’air de cette petite chambre, rendu insalubre par un mauvais chauffage dans le froid de l’hiver ! Examinons les dangers moraux de cette promiscuité : l’inimaginable initiation précoce des enfants aux choses détestables qui peuvent s’y passer ! Sentons la crasse, la saleté, inévitables dans la pauvreté de cette petite pièce – sentons cela dans notre corps : entassons-nous à quatre personnes épuisées, dans cette chambre exiguë, où les lits, les linges et les couvertures sont dans un état indescriptible !
Comment imaginer leurs conditions de vie, quand on n’y a pas grandi ?
Ensuite, représentons-nous dix pièces comme celle-là par étage, puis cinq étages semblables l’un au-dessus de l’autre. Cette misérable salle de torture est multipliée par cinquante ! Ensuite, représentons-nous dix immeubles de ce genre, soit cinq cents fois cette « chambre » maudite ! Continuons : Imaginons mille villes, 500 000 personnes entassées dans ces antres de malheur ! Les plus endurcis parviendront peut-être à se faire une idée de la misère qui sévit dans notre Allemagne, tandis que d’autres vivent toujours mieux dans le luxe, le confort et les belles demeures.
En Allemagne, un million de personnes sont sans logement. Dans les années qui viennent, la plupart de ces gens ne trouveront pas de situation décente. Bien sûr, dans tous les offices du logement, il y aura des égoïstes habiles capables de s’en sortir. Mais la plupart de ces malheureux luttent en vain pour trouver un logement décent, semaine après semaine, mois après mois, année après année. Combien parmi eux ont des enfants qui devront grandir dans des conditions indignes, sans le soutien de leurs parents, sans la communauté d’une famille – oui, surtout, sans un foyer !
Nous connaissons l’histoire de Noël, celle de l’enfant dans l’étable, qui ne trouvait pas de gîte parmi les humains. Nous aimons la mettre en images. Nous plaçons des crèches de Noël illuminées dans notre salle décorée pour la fête. Nous sommes édifiés en ressentant la pauvreté et la misère de l’enfant Jésus, né d’une mère sans abri dans une étable – loin des habitations humaines. Et néanmoins, nous tolérons que d’innombrables enfants restent sans logis, sans leur petit lit. Et cela dans notre « patrie », dans notre pays natal ! Pourquoi ne nous approchons-nous pas de ces enfants ? Ils n’ont même pas une étable à leur disposition pour se protéger de la tempête et de la pluie ! Aujourd’hui, pour beaucoup de ces personnes chassées d’un lieu à un autre, ce ne serait pas le plus mauvais logis. Des mères désespérées, dans l’incapacité de trouver un logement pour leur enfant, pensent même au suicide. Au moins, un enfant malheureux devenu orphelin a la perspective d’obtenir un lit, dans un orphelinat.
L’Etat se soucie des enfants dont on a diagnostiqué une maladie mentale, de ceux qui sont placés à l’ « assistance publique » en raison du comportement de leurs parents. L’office des mineurs, avec ses assistantes sociales, vient au secours de la jeunesse. Soyons reconnaissants pour ces efforts sociaux, solidement institués dans le domaine public. Ils sont un signe d’une misère qui ne cesse d’augmenter, mais aussi d’une responsabilité qui s’éveille dans la société. Notre Bruderhof reconnaît donc sans restriction ce service de l’Etat, par lequel il combat le « Mal » qui détruit la société – et il le fait très efficacement.
Mais l’Etat défend aussi le droit à la propriété et à la possession, et s’engage à le défendre. Il doit donc faire usage de la force, par la contrainte légale et militaire. Là réside sa faiblesse. Il reste en-dehors d’une manière chrétienne d’envisager l’existence. Nous payons nos impôts et nous acceptons l’aide sociale de l’Etat. Nous ne lui manifestons ni opposition ni critiques, pour autant qu’il ne mette pas en péril les deux orientations de notre vie de foi : l’amour et l’attente du Royaume de Dieu.
Allez visiter les enfants, tous ceux que vous rencontrerez !
L’aide sociale de l’Etat a pourtant ses limites. Il faut y ajouter le soutien indispensable, l’aide privée et personnelle, d’individus ou d’associations plus ou moins libres. Tant d’enfants restent dans la plus grande misère ! Ni malades mentaux ni délaissés par leurs parents, ils devraient quand même pouvoir bénéficier de l’aide sociale publique. Dans la plupart des cas, ils ne reçoivent aucune assistance financière, aucune allocation de la part de l’Etat pour subsister. Ces « cas limites » nécessitent tout particulièrement notre vigilance. Nous devons rester attentifs à toutes les détresses et examiner attentivement chaque cas. Ce n’est qu’en chargeant nos épaules de la misère du monde et en y prêtant attention que nous reconnaîtrons toute sa gravité et que nous pourrons partiellement contribuer à la soulager.
Allez visiter les enfants, tous ceux que vous rencontrerez ! Informez-vous du souci des innombrables mères qui portent leurs enfants dans leurs cœurs meurtris ! Réduisez, autant que vous le pouvez, vos besoins, pour pouvoir les accueillir dans vos foyers ! S’il ne vous est pas possible de faire plus sans mettre en danger la salubrité de votre habitation, si vous ne pouvez pas loger davantage de personnes chez vous, adressez-vous à des foyers pour enfants. Ils y seront élevés dans la confiance et la joie. On prendra bien soin d’eux. On permettra à leurs meilleures capacités de s’épanouir. Ne soyez pas comme l’aubergiste des vielles saynètes de Noël allemandes qui, pris par ses nombreux clients, n’avait plus rien de disponible, sinon une étable, pour l’enfant Jésus. Aimez l’enfant de Marie en chaque petit être malheureux ! Si vous ne l’aidez pas, il sera perdu corps et âme !
Extrait du livre Individualisme et misère du monde.

Note
- Franz Werfel, « An den Richter », in Der Gerichtstag in fünf Büchern, Leipzig, 1919, p.246-248.
- Franz Werfel, « Verzweiflung », in Wir sind, Leipzig, 1914, p.54.
- Franz Werfel, « Ich bin ja noch ein Kind », in Wir sind, Leipzig, 1914, p.91-93.
- Franz Werfel « An den Leser », in Gesänge aus den drei Reichen, Leipzig, 1917, p.4
- Max Stirner, « Der Enzige und sein Eigentum », Leipzig, 1972, p. 324.
- Cf. Franz Werfel, « Ich bin ja noch ein Kind ».
- Max Stirner, « Der Einzige und sein Eigentum », Leipzig, 1972, p.324.
- Cf. Karl Henkell, « Die Dampfwalze », in Buch des Kampfes, Munich, 1921, p.33.
- Arthur Schopenhauer, Le monde comme volonté et comme représentation, §59.
- Franz Werfel, « Gebet um Reinheit », in Der Gerichtstag, Leipzig, 1919, p. 249-251.
- Franz Werfel, « An den Richter », in Der Gerichtstag, Leipzig, 1919, p.246-248.
- Franz Werfel, « Gebet um Reinheit », in ibid.
- Arthur Schopenhauer, Le monde comme volonté et comme représentation, §63.
- Lc 13,2-5 (TOB)
- Martin Luther, WA (Werke, édition de Weimar) 1,25-39. Traduction de Marc Lienhard, in Martin Luther- Un temps, une vie, un message, Paris-Genève, 1983, p. 38. Extrait de ses Explications au sujet de la vertu des indulgences, datées du 30 mai 1518. Dans la 15ème de ses thèses, Luther écrit : « Cette crainte et cette épouvante sont suffisantes pour constituer à elles seules (pour ne pas parler du reste) la peine du purgatoire, car elles sont proches du désespoir » (in. Luther, Œuvres, Paris, Gallimard, 1999, p. 136).